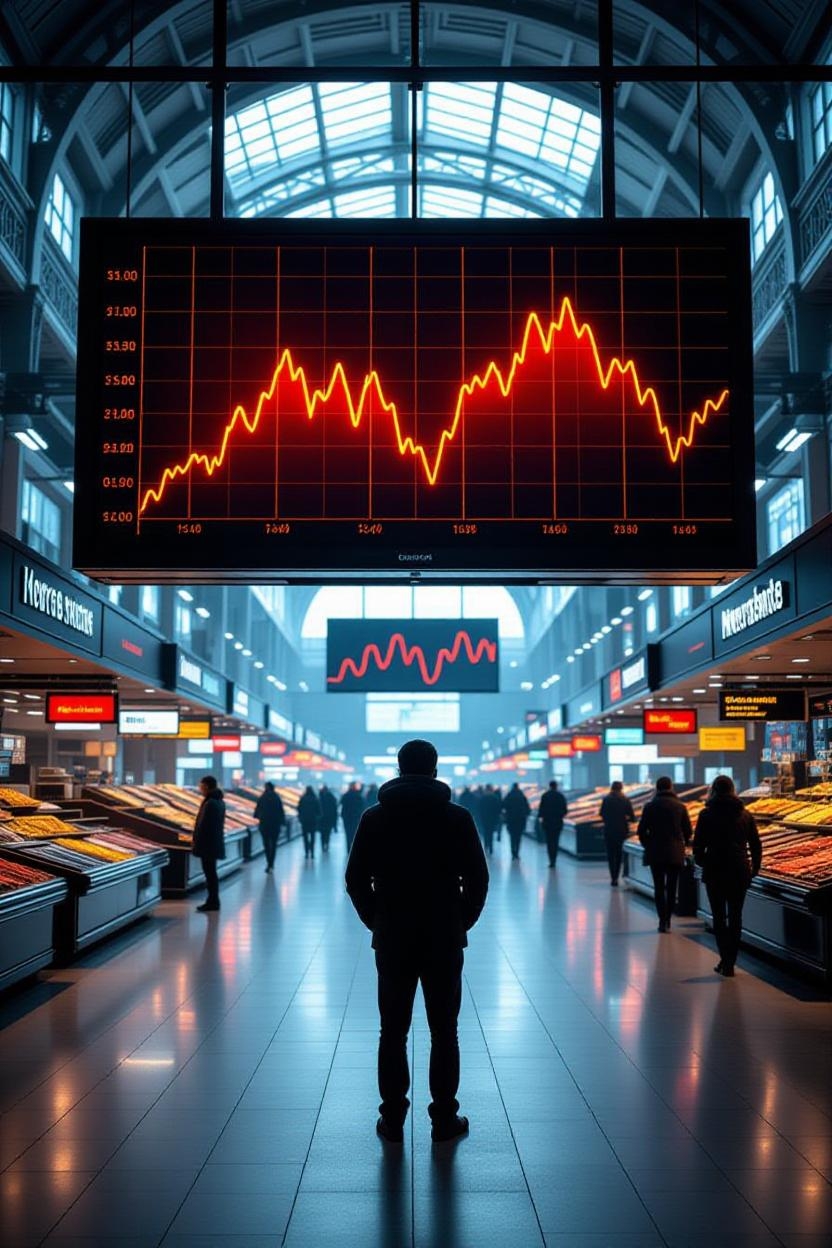
Par uneautrevie.org
Le capitalisme n’est pas un système économique neutre : c’est une architecture sociale conçue pour extraire la richesse de la majorité au profit d’une minorité. Son moteur repose sur une tension permanente : d’un côté, la coopération nécessaire des travailleurs ; de l’autre, la peur constante, pour les capitalistes, de voir cette solidarité devenir une force politique. Trop de cohésion populaire, et tout vacille.
Alors, pour protéger son édifice, la classe dominante a inventé deux armes puissantes : le camouflage du rôle réel de l’État dans l’accumulation du capital, et l’isolement du pouvoir économique des citoyens.
L’État n’est pas un arbitre : c’est un partenaire silencieux du capital
La fable du marché libre prétend que l’économie vit en dehors du politique. Que l’État doit “laisser faire” pour que les lois de l’offre et de la demande apportent à tous le bien-être matériel. Mais l’histoire prouve l’inverse.
À chaque crise – guerres, pandémies, effondrements financiers – ce sont les États qui volent au secours du capital, pas les marchés qui sauvent les peuples.
En 2020, face à la pandémie, des milliers de milliards furent injectés dans les économies mondiales. Puis, dès que le choc fut absorbé, les gouvernements ont brandi un vieux remède : l’austérité.
Ce mot, qui sonne comme une vertu, cache un mécanisme brutal : faire payer les coûts de la crise à ceux qui ne l’ont pas provoquée.
L’austérité : invention d’une classe pour discipliner l’autre
L’austérité n’est pas née avec Maastricht ou Bruxelles. Elle remonte à l’après-Première Guerre mondiale, quand les travailleurs, galvanisés par les sacrifices du front, revendiquaient une part du pouvoir.
Les élites économiques ont alors compris que le véritable danger n’était pas la dette publique, mais la démocratie sociale.
Elles ont donc conçu un récit : les pauvres dépensent trop, les États vivent au-dessus de leurs moyens, il faut “resserrer la ceinture”. En réalité, il s’agissait de rediriger les richesses vers les épargnants et les investisseurs “responsables”, tout en rendant la pauvreté à nouveau docile.
Depuis, ce récit n’a jamais cessé d’être rejoué :
après 1945, pour freiner les ambitions ouvrières ;
dans les années 1980, avec Reagan et Thatcher, pour “libérer” les marchés ;
après 2008, pour effacer les dettes… des banques ;
et aujourd’hui encore, dans l’Union européenne, où la Commission et la BCE redécouvrent la “discipline budgétaire”.
Technocratie et “indépendance” : le nouveau visage de la domination
Les architectes modernes de l’austérité ne portent plus de haut-de-forme : ils siègent à Francfort, Bruxelles, Washington ou Paris, sous le nom de “comités d’experts”.
Cette technocratie économique se présente comme apolitique, au-dessus des passions. Mais c’est justement là son génie : soustraire le pouvoir économique au débat démocratique.
Les banques centrales “indépendantes”, les agences de notation, les “règles d’or” budgétaires… tout concourt à rendre les politiques sociales illégitimes et les politiques d’austérité inévitables.
Derrière les formules de neutralité – “lutte contre l’inflation”, “réduction des déficits” – se cache une guerre de classe raffinée. La Banque centrale européenne, par exemple, a relevé ses taux dix fois entre 2022 et 2024, étranglant les budgets sociaux et freinant la transition écologique au nom d’une inflation déjà résorbée. Pendant ce temps, les profits du CAC 40 ont atteint des records historiques.
L’austérité comme contre-révolution permanente
L’austérité agit comme une police invisible : elle discipline sans frapper.
Elle rappelle aux travailleurs que toute amélioration sociale est provisoire, conditionnée à la “bonne santé” des marchés.
Elle maintient la peur du chômage comme arme économique, favorisant la soumission salariale.
Et surtout, elle détruit le lien entre démocratie et bien commun : même élus, les dirigeants disent “nous ne pouvons pas faire autrement”.
Pourtant, l’histoire récente montre qu’il existe toujours des alternatives.
Les plans de relance post-Covid avaient brièvement esquissé un autre modèle : celui d’un État qui investit massivement dans la santé, l’énergie, l’éducation.
Mais la fenêtre s’est refermée sous la pression des marchés financiers. En 2025, l’Europe revient au “pacte de stabilité”, synonyme d’écoles fermées, de retraites amputées, et de soins rationnés.
Le masque tombe
Comme l’écrivait Karl Marx, la coercition du capital est souvent “silencieuse”. Le travailleur, dépendant du salaire pour vivre, se soumet sans qu’on ait besoin de le contraindre physiquement.
Mais lorsque les crises s’enchaînent, le masque tombe.
Alors, l’austérité apparaît pour ce qu’elle est : un instrument de guerre sociale déguisé en gestion comptable.
Révéler cela n’est pas un exercice de théorie, c’est une nécessité politique.
Car tant que l’austérité semblera “raisonnable”, le capital continuera de régner.
Mais lorsque ses justifications morales tomberont, peut-être apercevrons-nous enfin la faille dans l’armure.
Conclusion : Rompre le charme
Ce que les économistes néolibéraux appellent “réalisme” n’est qu’un mot poli pour résignation.
Rompre le charme, c’est refuser cette résignation.
C’est rappeler que l’économie n’est pas une loi de la nature, mais un choix collectif ;
que la démocratie n’a pas vocation à s’arrêter aux portes des banques centrales ;
et que l’austérité n’est pas une fatalité, mais un choix politique, au service d’une minorité.
Sources
Clara E. Mattei, L’Ordre capital (La Découverte, 2024)
OCDE : Economic Outlook 2025
BCE : Rapport sur la stabilité financière, juin 2025
FMI : Global Fiscal Monitor, septembre 2025
Karl Marx, Le Capital, vol. I
📰 Austerity: The Silent War of Capital Against Democracy
By uneautrevie.org
Capitalism is not a neutral economic system — it is a social architecture designed to extract wealth from the many for the benefit of the few.
Its engine runs on permanent tension: on one side, the cooperation of workers; on the other, the constant fear of capitalists that this solidarity might one day turn political. Too much cohesion from below, and the system trembles.
To protect itself, the ruling class has perfected two powerful tools: concealing the true role of the state in sustaining capital accumulation, and shielding economic power from democratic interference.
The State Is No Referee — It’s the Capital’s Silent Partner
The myth of the “free market” tells us that the economy lives apart from politics. That the state must “step aside” and let the laws of supply and demand deliver prosperity to all.
But history tells a very different story.
Whenever crisis hits — wars, financial collapses, pandemics — it is the state that rescues capital, not the market that saves the people.
In 2020, faced with the pandemic, governments across the world injected trillions into their economies. And yet, once the shock was absorbed, they dusted off an old remedy: austerity.
The word sounds virtuous — “discipline”, “responsibility” — but its real function is brutal: to make the victims of the crisis pay for it.
Austerity: A Class Invention to Discipline the Other
Austerity did not begin with Maastricht or Brussels. It was born in the aftermath of World War I, when workers — having sacrificed everything — demanded a share of power.
Economic elites quickly understood that the real threat was not public debt but social democracy itself.
So they crafted a narrative: the poor spend too much, the state lives beyond its means, and the only cure is to “tighten belts.”
In truth, austerity’s aim was to redirect wealth toward the “responsible” investors and savers, while making poverty obedient again.
That story has been replayed endlessly:
after 1945, to curb postwar worker militancy;
in the 1980s, under Reagan and Thatcher, to “liberate” markets;
after 2008, to erase the debts — of banks;
and again today, in the European Union, as Brussels and the ECB rediscover “fiscal discipline”.
Technocracy and “Independence”: The New Face of Domination
Today’s architects of austerity no longer wear top hats. They sit in Frankfurt, Brussels, Washington, or Paris, and call themselves “experts.”
This technocratic class claims to be apolitical, rational, scientific — and that is precisely its strength: to remove economic decisions from democratic debate.
Independent central banks, rating agencies, fiscal “golden rules”… all of it works to make social policy illegitimate and austerity unavoidable.
Behind neutral phrases like “fighting inflation” or “reducing deficits” hides a refined class war.
The European Central Bank, for instance, raised interest rates ten times between 2022 and 2024, strangling public investment and slowing ecological transition — in the name of curbing an inflation already fading. Meanwhile, corporate profits on the CAC 40 reached historic highs.
Austerity as Permanent Counter-Revolution
Austerity acts as an invisible police.
It disciplines without beating.
It reminds workers that every social gain is temporary, conditional on the “health” of the markets.
It maintains the fear of unemployment as an economic weapon, ensuring submission through scarcity.
And above all, it severs democracy from the common good: even elected governments now say, “we have no choice.”
Yet history shows that alternatives do exist.
The post-Covid recovery plans briefly sketched another model — one where the state invested massively in health, energy, and education.
But that window closed under the pressure of financial markets.
By 2025, Europe is back to its “stability pact”: a euphemism for closed schools, frozen pensions, and rationed hospitals.
When the Mask Falls
As Karl Marx wrote, capital’s coercion is often “silent.” The worker, dependent on wages to survive, submits without needing to be forced.
But when crises multiply, the mask slips.
Then austerity appears for what it truly is: an instrument of social warfare disguised as budget management.
Exposing this truth is not an academic exercise — it is a political necessity.
For as long as austerity appears “reasonable,” capital will continue to rule.
But when its moral justifications crumble, we may finally glimpse the crack in its armor.
Breaking the Spell
What neoliberal economists call “realism” is nothing but a polite word for resignation.
Breaking the spell means refusing resignation.
It means remembering that the economy is not a law of nature, but a collective choice.
That democracy should not stop at the doors of central banks.
And that austerity is not fate — it is a political choice, serving a minority at the expense of the majority.
References
Clara E. Mattei, The Capital Order (Penguin, 2024)
OECD, Economic Outlook 2025
European Central Bank, Financial Stability Review, June 2025
IMF, Global Fiscal Monitor, September 2025
Karl Marx, Capital, Vol. I
