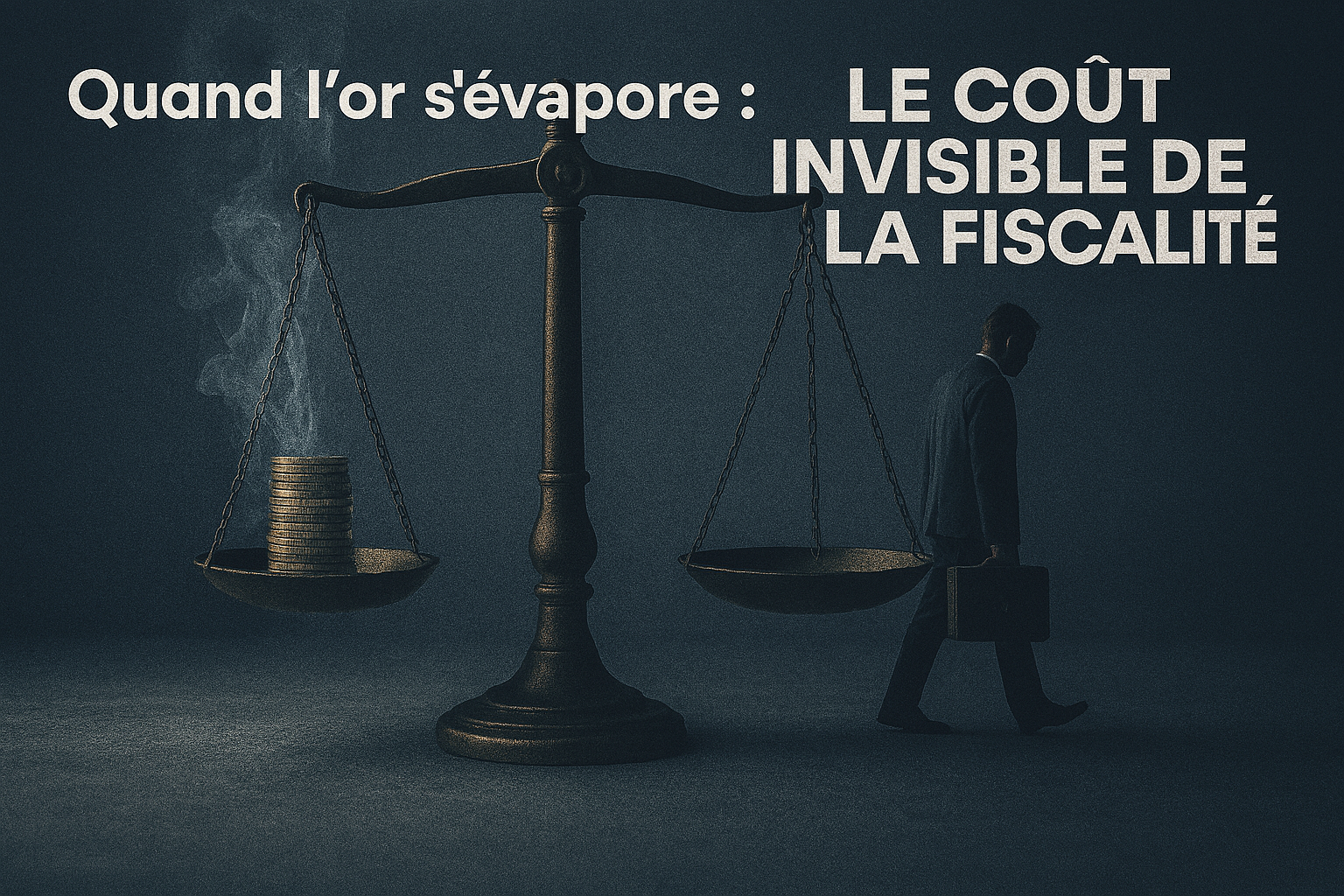
À force de croire que « plus d’impôt » signifie « plus de recettes », les gouvernements rejouent la même comédie : celle d’un État glouton qui finit par se mordre la main qui le nourrit.
Car il existe une loi économique que ni les discours moralisateurs ni les PowerPoint ministériels ne peuvent abolir : au-delà d’un certain seuil, l’impôt détruit sa propre base.
D’abord les contribuables paient, puis ils s’organisent. Et quand ils partent, c’est toute l’économie qui tousse.
Le mythe du rendement fiscal illimité
L’idée qu’on puisse augmenter sans fin les taux pour “faire rentrer de l’argent” est une tentation vieille comme la fiscalité.
Mais la courbe de Laffer, caricaturée pendant quarante ans, garde une vérité simple : les comportements s’adaptent.
Arthur Laffer l’avait dessinée sur une serviette ; Emmanuel Saez, Gabriel Zucman ou Joel Slemrod l’ont depuis confirmée empiriquement — y compris dans leurs critiques de la sur-concentration des hauts revenus.
Autrement dit : l’élasticité de l’assiette fiscale n’est pas une lubie libérale, c’est une réalité mesurable.
Regardons les faits :
Royaume-Uni, 2010. Le taux marginal d’imposition des revenus passe de 40 % à 50 %. Résultat : explosion du “forestalling” (avancement de revenus pour éviter la surtaxe) et chute du rendement. Trois ans plus tard, le taux retombe à 45 %. Le Trésor reconnaît que la mesure “a rapporté moins qu’espéré”.
France, 2012. Le taux d’imposition des plus hauts revenus grimpe à 75 %. Symbolique, éphémère et coûteuse : la mesure est supprimée deux ans plus tard après une vague d’optimisations et de départs fiscaux — y compris de footballeurs, ce qui est toujours mauvais pour la popularité d’un gouvernement.
États-Unis, 2021-2025. L’administration Biden augmente la fiscalité des plus-values au-delà de 1 million $. Le Congressional Budget Office observe un recul de 12 % des ventes d’actifs imposables dès l’année suivante. Même Washington, temple du keynésianisme fiscal, découvre que le contribuable ne se laisse pas tondre sans broncher.
Ces épisodes illustrent la même mécanique : le rendement fiscal maximal se situe toujours en deçà du taux politique maximal.
Quand le capital plie bagage
Si le travail est élastique, le capital est liquide.
Et quand un gouvernement le taxe trop, il ne proteste pas — il s’évapore.
La Norvège l’a appris à ses dépens : en 2022, elle augmente son impôt sur la fortune. En 2023, une cinquantaine de grandes fortunes (dont le fondateur de Kahoot!) s’installent en Suisse.
Selon une étude de l’Université de Bergen (2024), chaque point de taxe supplémentaire sur la fortune réduit de 1,8 % le nombre de contribuables concernés en trois ans.
Un exil discret mais durable, et un manque à gagner estimé à 3 milliards de couronnes par an en impôts futurs.
Le Royaume-Uni, lui, a cru bien faire en supprimant le régime des non-doms — ces résidents étrangers bénéficiant d’un statut fiscal allégé.
Résultat : des dizaines de milliers de départs annoncés (l’OBR évoque jusqu’à 16 000), des investisseurs inquiets, et une City qui perd un peu de son éclat.
Et pendant ce temps, la France constatait l’inverse :
la transformation de l’ISF en IFI en 2018, décriée comme “cadeau aux riches”, a coïncidé avec une baisse de 40 % des départs fiscaux et un retour d’investissements privés estimé à 2,5 milliards € selon la Banque de France.
Autrement dit : la stabilité fiscale rapporte plus que la vengeance symbolique.
L’impôt punitif, un poison lent
Quand un État taxe par réflexe politique plutôt que par stratégie économique, il finit par tuer la confiance.
Et la confiance, c’est la vraie monnaie d’un pays.
Chaque hausse d’impôt non anticipée agit comme un choc de défiance :
les investisseurs attendent,
les entrepreneurs gèlent leurs projets,
les ménages épargnent au lieu de consommer.
La conséquence est bien connue des économistes de l’OCDE : le multiplicateur fiscal devient négatif.
L’impôt ne finance plus les services publics, il alimente la méfiance et la fuite.
En France, ce paradoxe s’observe chaque année : malgré un taux de prélèvements obligatoires record (45,5 % du PIB), les recettes nettes stagnent autour de 1 180 milliards €.
Pourquoi ? Parce que la base productive — PME, indépendants, cadres techniques — s’érode.
Et quand la base se rétrécit, le fardeau retombe sur ceux qui ne peuvent ni s’expatrier ni se réorganiser : les classes moyennes.
L’équilibre oublié : prévisibilité et justice
Faut-il alors baisser tous les impôts ? Non.
Mais il faut choisir : mieux vaut un impôt juste, stable et intelligible qu’un impôt moralisateur et instable.
L’exemple du Danemark est éclairant : taux marginaux élevés, mais stables depuis vingt ans, avec une transparence totale sur l’usage des fonds. Résultat : peu d’évasion, forte adhésion.
L’impôt, en démocratie, n’est pas qu’un outil de financement — c’est un contrat moral.
Quand il devient un instrument de punition ou de communication, il perd son efficacité économique et sa légitimité politique.
Et quand il détruit la confiance, il finit par appauvrir l’État qu’il prétend sauver.
🧭 En résumé
Les hausses fiscales excessives provoquent des réactions d’évitement mesurables.
Royaume-Uni, Norvège, France : trois expériences récentes prouvent la fragilité du rendement fiscal.
Le capital fuit plus vite que le travail.
La stabilité fiscale attire davantage que la surimposition idéologique.
Trop d’impôt ne tue pas seulement la richesse — il tue la confiance.
:
🇬🇧 English version – “When Taxes Backfire”
Too Much Tax Kills the Base — and Sometimes the State
Governments love to believe that “more tax” means “more revenue.”
But there’s a brutal economic law they keep forgetting: beyond a certain point, taxation destroys its own base.
At first, taxpayers comply. Then they adapt. And when they leave, the entire economy catches a cold.
The Myth of Infinite Fiscal Yield
The idea that you can raise rates indefinitely and fill the treasury is as old as taxation itself.
Yet Laffer’s famous curve — once dismissed as a Reagan-era relic — remains stubbornly true.
Raise rates too far, and behavior changes. Economists from Arthur Laffer to Emmanuel Saez and Joel Slemrod have confirmed it with data: the tax base is elastic.
A few real-world reminders:
- United Kingdom, 2010: Top income tax raised from 40% to 50%. Massive “forestalling” effect — people shifted income to the previous year. Three years later, the rate fell to 45%, with little net loss to the Treasury.
- France, 2012: A 75% “super-tax” on top earners lasted barely two years. Symbolic, inefficient, and politically costly.
- United States, 2021–25: Biden’s capital gains hike led to a 12% drop in taxable asset sales. Even Washington learned that the taxpayer moves faster than Congress.
The pattern is universal: the fiscal sweet spot lies below the political comfort zone.
When Capital Votes with Its Feet
Work can adjust. Capital can flee.
Norway learned this in 2022 when it raised its wealth tax. Within months, dozens of entrepreneurs — including the founder of Kahoot! — relocated to Switzerland.
A 2024 University of Bergen study found that a one-point wealth tax hike reduces the number of affected taxpayers by nearly 2% within three years.
Revenue rose on paper, but the real base — companies, jobs, investment — shrank.
Britain repeated the same mistake by scrapping its non-dom regime, prompting an exodus of wealthy residents.
Meanwhile, France’s transformation of the ISF into the IFI had the opposite effect: a 40% drop in fiscal expatriations and billions in repatriated investment.
Stability pays better than symbolism.
The Hidden Cost: Trust
Tax policy isn’t just about numbers — it’s about trust.
When governments tax out of ideology rather than prudence, they don’t just lose money; they lose credibility.
And once confidence collapses, no tax rate can fix it.
The OECD notes that in high-tax economies, unpredictable hikes have negative multipliers: they dampen growth instead of funding services.
France, with one of the world’s highest tax burdens (45.5% of GDP), sees stagnating revenues precisely because its productive base is eroding.
Middle classes and small businesses shoulder the weight that mobile capital has escaped.
A Smarter Balance
The solution isn’t blind tax cuts — it’s predictability and fairness.
Denmark proves the point: high rates, but stable, transparent, and widely accepted.
When people trust the rules, they comply. When they don’t, they leave.
Too much tax doesn’t just kill investment.
It kills confidence — and with it, the very foundations of the State.
Key Takeaways
- Fiscal behavior is elastic, not static.
- Excessive taxation reduces, not increases, long-term revenue.
- The capital flight effect is real and measurable.
- Stable, fair taxation yields more than punitive symbolism.
- Confidence is the real tax base.
