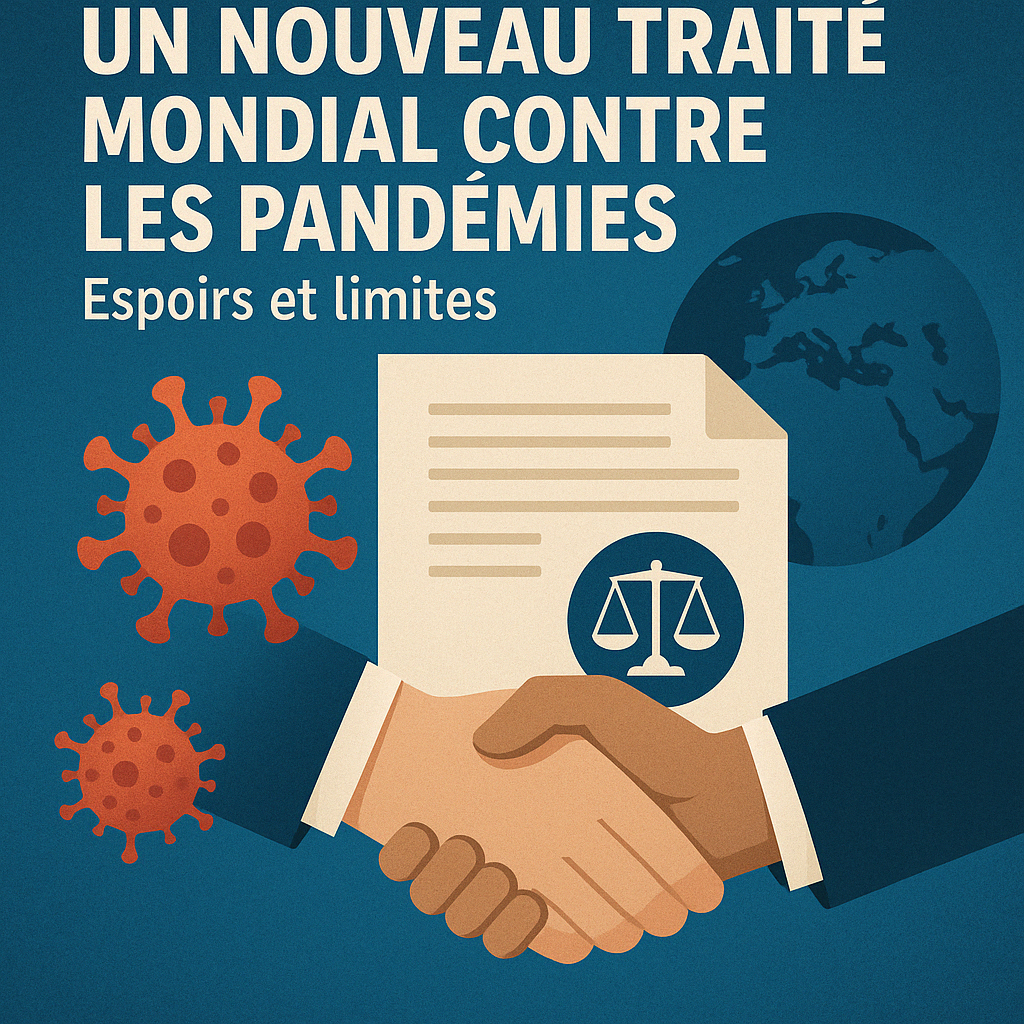
Cinq ans après la pandémie de Covid-19, qui a coûté la vie à plus de 7 millions de personnes et exposé les profondes inégalités entre pays du Nord et du Sud concernant l'accès aux soins médicaux, aux vaccins et aux traitements, près de 200 pays se mobilisent pour prévenir une nouvelle crise sanitaire mondiale.
Le mercredi 16 avril 2025, après plusieurs années d'intenses négociations, les représentants de ces pays sont parvenus à un consensus sur un traité international sur les pandémies, destiné à renforcer la coopération et à mieux préparer la communauté internationale face aux futures crises sanitaires. Ce texte juridiquement contraignant pourrait être officiellement adopté dès le mois prochain, lors de l’Assemblée mondiale de la santé à Genève.
Parmi les principales mesures du traité figurent l'obligation pour les États de renforcer la surveillance sanitaire, d'améliorer la transparence et la rapidité du partage des diagnostics, vaccins et traitements, de mieux prévenir les zoonoses (transmission des virus des animaux à l'homme), et d’investir significativement dans leurs systèmes de santé nationaux.
« Nous n'avons certes pas atteint tous nos objectifs initiaux, mais nous sommes convaincus que, s'il est effectivement appliqué, ce traité rendra le monde plus résilient face aux menaces sanitaires », a souligné un négociateur représentant l'Union européenne lors de la clôture des discussions.
Des points de désaccord persistent cependant, notamment sur la question sensible du transfert de technologie. Les pays à faibles revenus réclamaient un cadre contraignant permettant la fabrication locale des médicaments et vaccins, mais les pays plus riches, comme ceux de l’Union européenne, ont plaidé pour un transfert volontaire et « mutuellement consenti » des technologies. « Nous avons insisté pour que le transfert de technologie demeure volontaire pour les détenteurs, ce qui est reflété dans le texte actuel », a précisé le représentant allemand.
Un autre enjeu crucial reste partiellement en suspens : le système d’accès aux agents pathogènes et de partage des bénéfices (PABS). Ce dispositif vise à garantir aux pays partageant des échantillons de pathogènes un accès prioritaire aux traitements et aux vaccins développés. Bien qu’un accord de principe ait été trouvé, les modalités précises de ce mécanisme restent à déterminer dans les mois à venir et feront l’objet d’annexes au traité.
Selon Lawrence Gostin, directeur du Centre collaborateur de l'OMS sur le droit sanitaire mondial à l'université de Georgetown, « ce système pourrait permettre aux régions les plus pauvres, notamment en Afrique, de devenir autonomes en situation de pandémie, sans dépendre exclusivement de dons extérieurs ».
Malgré ses limites, le traité représente un progrès significatif. Suerie Moon, codirectrice du Global Health Centre de Genève, souligne : « Certes, la pandémie de Covid-19 a révélé de nombreuses lacunes que ce texte ne règlera pas entièrement, mais tous les pays bénéficieront incontestablement d'une meilleure coordination sanitaire internationale ».
Un enjeu majeur demeure cependant : l'absence notable des États-Unis, qui se sont retirés des négociations en janvier 2025 dans le cadre de leur désengagement plus large vis-à-vis de l’OMS. Cette absence pourrait affaiblir certaines dispositions clés, notamment l'obligation pour les « fabricants participants » de réserver 10 % de leur production de vaccins et médicaments à l'OMS, avec la possibilité d'en donner 10 % supplémentaires. L’incertitude autour de l’implication des grandes entreprises pharmaceutiques américaines laisse planer un doute sur l’efficacité réelle de ces mesures en cas de future pandémie.
Le mois prochain, le traité sera soumis à un vote formel lors de l’Assemblée mondiale de la santé à Genève. S’il est adopté, ce sera seulement le deuxième traité international négocié sous l'égide de l'OMS depuis sa création en 1948, le premier étant celui sur la lutte contre le tabagisme en 2003.
Alors que les experts s’accordent à dire que l’apparition d’une nouvelle pandémie n’est qu’une question de temps, ce traité pourrait bien façonner durablement la réponse mondiale face aux futures urgences sanitaires.
